Coup d’État, rébellion armée, guerre postélectorale, milliers de morts : la Côte d’Ivoire porte encore les cicatrices de deux décennies de violences politiques. Pourtant, si certains acteurs ont été jugés, d’autres semblent durablement protégés par un silence international troublant. L’absence de poursuites équitables et la complaisance des organisations de défense des droits de l’homme sont préoccupantes : assiste-t-on à une justice universelle ou à une justice sélective, dictée par la realpolitik ?

La Côte d’Ivoire offre l’un des cas les plus emblématiques de la crise de crédibilité de la justice internationale et des organisations de défense des droits de l’homme. Depuis le coup d’État du 24 décembre 1999 jusqu’à la fin de la crise postélectorale de 2010-2011, le pays a connu une succession de violences politiques majeures : rébellion armée, partition du territoire, massacres de civils, exactions documentées. Pourtant, la réponse internationale à ces crimes demeure profondément déséquilibrée.

À l’issue du conflit postélectoral, Laurent Gbagbo a été transféré à la Cour pénale internationale, en même temps que son ministre Charles Blé Goudé. Après huit années de procédure, les deux hommes ont été acquittés, faute de preuves établissant leur responsabilité pénale. Cet acquittement aurait logiquement dû ouvrir une nouvelle phase : la poursuite des enquêtes sur l’autre camp belligérant, conformément au principe d’impartialité. Or, cette étape n’a jamais eu lieu.
Le dossier ivoirien semble désormais clos pour la CPI, pour l’ONU et pour la plupart des grandes ONG internationales. Alassane Ouattara, pourtant cité dans de nombreux témoignages et rapports pour des crimes commis par des forces qui lui étaient favorables, bénéficie d’un silence quasi total. Pire encore, ce silence se transforme en approbation tacite lorsqu’il est applaudi sur la scène internationale, y compris lorsqu’il s’autorise des interprétations contestées de la Constitution pour briguer un quatrième mandat.

Les organisations internationales de défense des droits de l’homme — Amnesty International, Human Rights Watch, Fédération internationale pour les droits humains, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, ou encore la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples — se présentent comme des vigies universelles. Pourtant, dans le cas ivoirien, leur attitude illustre un silence sélectif, et non une prudence juridique.
Ce silence n’est pas neutre. Les faits sont connus, documentés, relayés par les victimes, les ONG locales et parfois par des rapports internes. Mais ils ne franchissent jamais le seuil de la condamnation publique dès lors qu’ils concernent un régime considéré comme allié stratégique ou stabilisateur. Le langage se fait alors vague, dilué dans des formules telles que « violences de part et d’autre » ou « contexte complexe », produisant une symétrie artificielle qui efface les responsabilités réelles.
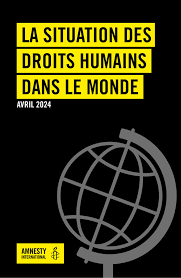
Cette hiérarchisation implicite des victimes crée une injustice mémorielle profonde. Certaines souffrances méritent enquêtes et indignation immédiate ; d’autres sont reléguées au silence. En Afrique, cette attitude est perçue comme une prolongation de la realpolitik internationale, où la stabilité géopolitique prime sur la justice.
En définitive, le silence des organisations de défense des droits de l’homme devient une violence symbolique. Il nie la souffrance des victimes ivoiriennes, empêche toute réconciliation sincère et entretient l’idée dangereuse d’une justice des vainqueurs. Une justice qui s’arrête à mi-chemin cesse d’être une justice ; elle devient un instrument politique.
Germain Séhoué


































